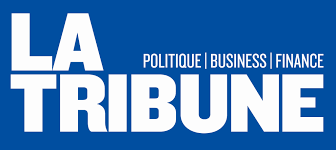L’ouverture récente d’une ligne Paris-Kuala Lumpur par Air Asia X à un prix défiant toute concurrence a retenu l’attention de nombreux commentateurs, qui ont vu dans cet événement la naissance d’une « low cost » sur le long-courrier, marché jusqu’ici aux mains des majors. Il est vrai que la compagnie malaisienne n’a pas hésité à brandir elle-même l’étendard du « low cost », lorsque les Ryanair et Easyjet lui préfèrent celui de « low fare ». Mais suffit-il de revendiquer une appellation pour en incarner véritablement l’esprit ? Rien n’est moins sûr.
L’essence du « low cost » aérien repose sur un principe simple et intangible : un avion en vol constitue un centre de profit, tandis qu’au sol il est une source de coûts. Toute la logique du modèle « low cost » en découle : afin de faire voler au maximum les avions chaque jour, les temps d’escale doivent être réduits au minimum, ce qui suppose de simplifier et de standardiser les processus de production et les prestations offertes, d’utiliser des aéroports non congestionnés et surtout de renoncer à la logique d’une organisation du réseau en étoile – le hub avec ses correspondances et ses temps d’attente – au profit d’un modèle de point à point. On comprend pourquoi le court/moyen-courrier constitue le terrain de prédilection des « low cost » : sur des vols de moins de trois heures, le « low cost » parvient à faire la différence en termes de coût par siège/kilomètre offert avec les compagnies traditionnelles, en réalisant une rotation supplémentaire par jour.
Mais à l’évidence un tel système n’est pas duplicable sur le long-courrier, compte tenu de la longue durée des vols et des temps d’escale incompressibles. Les expériences passées de low-cost long-courrier initiées par des compagnies occidentales se sont d’ailleurs soldées jusqu’ici par un échec, que ce soit le Skytrain lancé dans les années 1970 entre Londres et New York ou plus récemment la compagnie Zoom Airlines à partir du Canada. Le modèle « low cost » n’est tout simplement pas soluble dans le long-courrier. Il est vrai qu’Air Asia X ressemble à s’y méprendre à une compagnie « low cost », si l’on se tourne du côté des sources de revenus. La compagnie reprend à son compte certains attributs qui ont fait le succès des « low cost », comme des prestations secondaires en option: le repas à bord, le bagage supplémentaire ne sont plus inclus dans le prix du billet mais deviennent payants. Mais s’agit-il vraiment d’une caractéristique propre aux « low cost » ? On peut en douter, à l’heure où les compagnies traditionnelles se lancent également dans le jeu des options payantes sur le court/moyen-courrier, sans pour autant renoncer à ce qui fait leur nature : l’organisation en « hub ».
En réalité, si Air Asia X est qualifiée de low-cost, c’est d’abord parce qu’elle pratique des prix bas, pour le plus grand profit des consommateurs. Mais ces baisses de prix, si elles résultent sans doute d’une meilleure efficacité organisationnelle, sont d’abord la conséquence de baisses de coûts qui n’ont pas grand-chose à voir avec le modèle « low cost » mais qui portent un nom bien connu : la mondialisation. Avec son lot de différences : différences de rémunérations et de conditions de travail ; différences de charges sociales et de taxes, etc… L’arrivée d’Air Asia X en Europe, comme celle des compagnies du Moyen-Orient, illustre davantage la montée en puissance des pays émergents dans l’économie mondiale, pays qualifiés par abus de langage de « low cost », que la naissance d’un modèle « low cost » sur le long-courrier. Au sens premier du terme, la compagnie Air Asia X n’est pas plus « low cost » que les tee-shirts importés à bas prix en Europe… ou que les iPhone fabriqués à bas coûts en Chine et vendus à prix d’or chez nous. L’expérience d’Air Asia X vient nous rappeler qu’il ne suffit pas de produire à bas coûts pour être « low cost » ; il ne suffit pas non plus de vendre à bas prix.